
Film de 1950- Durée : 1H52
D’après le roman de William R.Bennett
Avec Sterling Hayden (Dix), Louis Calhern ( Emmerich), Jean Hagen (Doll) ; James Whitmore(Gus), Sam Jaffe (Riedenschneider), Mark Laurence (Cobby), Marilyn Monroe (Angela) Un malfaiteur distingué évadé de prison, Doc Riedenschneider, prépare un nouveau cambriolage dans une bijouterie dont le butin s’élèverait à un demi-million de dollars. Il réunit la somme nécessaire à l'opération puis une équipe (Louis ; briseur de coffres, le chauffeur-barman bossu Gus, le taciturne Dix Handley comme homme de main, et Emmerich le financier avocat de bonne société marié à une femme maladive et amoureux de l’insouciante Angela) .
Dès les premiers plans, John Huston instaure une atmosphère obscure et nocturne: des rues désertes et oppressantes, marquées par le temps, sombres, menaçantes, des immeubles délabrés, comme un écho aux physiques accidentés de ceux qui y déambulent et s’y égarent. Une jungle fatale. La jungle de la ville, quand la ville, l’autre, dort. La fatalité du film noir.
Huston comme souvent est fasciné par le milieu des gangsters et notamment par les romans de Bennett et la précision de sa peinture de l’humanité, par la présence des personnages qu’il décrit. Il dépeint en effet des personnages dont le destin tragique est inscrit, inéluctable, victimes de leurs passions et leurs obsessions qui les condamnent. Huston s’intéresse avant tout aux fêlures des personnages qui les conduiront à leurs pertes, qui les rendent si humains et induisent l’identification du spectateur. Chaque esquisse est brillante, un simple geste ou une simple parole suffisent souvent à définir un personnage, à déceler leur part d’humanité et de fragilité ordinaires : le bookmaker que l’argent fait transpirer, le barman bossu et accessoirement chauffeur lors du cambriolage défenseur ds chats, le spécialiste des coffres qui évoque la fièvre de ses enfants comme un honnête père de famille tout en volant des bijoux. Ces gestes sont aussi emblématiques de ce qui conduira chacun à sa perte. Dans une scène célèbre Riedenschneider sera ainsi victime de son amour des femmes : hypnotisé par la danse lascive d’une jeune femme, il ne verra pas les policiers qui le guettent. La scène n’est pas dénuée d’ironie. L’ironie du désespoir ou plutôt ici, des désespérés. Le personnage de Dix interprété par Sterling Hayden est à la fois violent, orgueilleux, solitaire mais aussi touchant et son allure à la fois dégingandée et brutale campe magnifiquement ce personnage ambivalent et emblématique du film noir, condamné à mourir. Qu’elles soient prêtes à mourir par amour (Doll) ou à aimer aussi vite qu’à dénoncer par opportunisme (formidable personnage d’Angela, apparition lumineuse de Marilyn Monroe, innocemment cynique), les femmes, quant à elles, sont ici moins aveugles et victimes qu’il n’y paraît, même si elles ne sont qu’un rouage dans la machine infernale de la fatalité.
Si le film, un polar noir et dense, sorte de radiographie implacable de l’échec , est avant tout un classique du septième art pour la richesse de ses personnages, la précision de leurs motivations, la mise en scène et le décor étouffant qui semble encercler les personnages comme leur destin fatal les asphyxie, sont aussi remarquables, et le son des sirènes qui s’apparentent à des « cris d’âmes en enfer » renforcent cette impression de tragédie inéluctable et suffocante. Pour que surgisse la lumière, il faudra attendre l’ultime seconde, la seule scène à se dérouler de jour et hors de la ville, au milieu de chevaux aussi carnassiers que libres… Ultime seconde hors de la jungle. Ultime et fatale seconde : tel est le destin des protagonistes d’un film noir dont « Quand la ville dort » est un modèle du genre à ne pas manquer et que copièrent ou dont s’inspirèrent ensuite de nombreux cinéastes.
"Sur la route de Madison" de Clint Eastwood
 L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.
L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.
Sur la route de Madison aurait alors pu être un mélodrame mièvre et sirupeux, à l’image du best-seller de Robert James Waller dont il est l’adaptation. Sur la route de Madison est tout sauf cela. Chaque plan, chaque mot, chaque geste suggèrent l’évidence de l’amour qui éclôt entre les deux personnages. Ils n’auraient pourtant jamais dû se rencontrer : elle a une quarantaine d’années et, des années auparavant, elle a quitté sa ville italienne de Bari et son métier de professeur pour se marier dans l’Iowa et y élever ses enfants. Elle n’a plus bougé depuis. A 50 ans, solitaire, il n’a jamais suivi que ses désirs, parcourant le monde au gré de ses photographies. Leurs chemins respectifs ne prendront pourtant réellement sens que sur cette route de Madison. Ce jour de 1965, ils n’ont plus d’âge, plus de passé, juste cette évidence qui s’impose à eux et à nous, transparaissant dans chaque seconde du film, par le talent du réalisateur Clint Eastwood. Francesca passe une main dans ses cheveux, jette un regard nostalgico-mélancolique vers la fenêtre alors que son mari et ses enfants mangent, sans lui parler, sans la regarder: on entrevoit déjà ses envies d’ailleurs, d’autre chose. Elle semble attendre Robert Kincaid avant même de savoir qu’il existe et qu’il viendra.
Chaque geste, simplement et magnifiquement filmé, est empreint de poésie, de langueur mélancolique, des prémisses de leur passion inéluctable : la touchante maladresse avec laquelle Francesca indique son chemin à Robert; la jambe de Francesca frôlée furtivement par le bras de Robert; la main de Francesca caressant, d'un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; la main de Robert qui, sans se retourner, se pose sur la sienne; Francesca qui observe Robert à la dérobée à travers les planches du pont de Roseman, puis quand il se rafraîchit à la fontaine de la cour; et c’est le glissement progressif vers le vertige irrésistible. Les esprits étriqués des habitants renforcent cette impression d’instants volés, sublimés.
Francesca, pourtant, choisira de rester avec son mari très « correct » à côté duquel son existence sommeillait, plutôt que de partir avec cet homme libre qui « préfère le mystère » qui l’a réveillée, révélée, pour ne pas ternir, souiller, ces 4 jours par le remord d’avoir laissé une famille en proie aux ragots. Aussi parce que « les vieux rêves sont de beaux rêves, même s’ils ne se sont pas réalisés ».
Et puis, ils se revoient une dernière fois, un jour de pluie, à travers la vitre embuée de leurs voitures respectives. Francesca attend son mari dans la voiture. Robert est dans la sienne. Il suffirait d’une seconde… Elle hésite. Trop tard, son mari revient dans la voiture et avec lui : la routine, la réalité, la raison. Puis, la voiture de Francesca et de son mari suit celle de Robert. Quelques secondes encore, le temps suspend son vol à nouveau, instant sublimement douloureux. Puis, la voiture s’éloigne. A jamais. Les souvenirs se cristalliseront au son du blues qu’ils écoutaient ensemble, qu’ils continueront à écouter chacun de leur côté, souvenir de ces instants immortels, d’ailleurs immortalisés des années plus tard par un album de photographies intitulé « Four days ». Avant que leurs cendres ne soient réunies à jamais du pont de Roseman. Avant que les enfants de Francesca ne réalisent son immense sacrifice. Et leur passivité. Et la médiocrité de leurs existences. Et leur envie d'exister, à leur tour. Son sacrifice en valait-il la peine ? Son amour aurait-il survécu au remord et au temps ?...
Sans esbroufe, comme si les images s’étaient imposées à lui avec la même évidence que l’amour s’est imposé à ses protagonistes, Clint Eastwood filme simplement, majestueusement, la fugacité de cette évidence. Sans gros plan, sans insistance, avec simplicité, il nous fait croire aux« certitudes qui n’arrivent qu’une fois dans une vie » ou nous renforce dans notre croyance qu’elles peuvent exister, c'est selon. Peu importe quand. Un bel été de 1965 ou à un autre moment. Peu importe où. Dans un village perdu de l’Iowa ou ailleurs. Une sublime certitude. Une magnifique évidence. Celle d’une rencontre intemporelle et éphémère, fugace et éternelle. Un chef d’œuvre d’une poésie sensuelle et envoûtante. A voir absolument.
Pour d'autres critiques de classiques du cinéma, rendez-vous dans la rubrique "Gros plan sur des classiques du 7ème art", sur inthemoodforcinema.com, en cliquant ici.
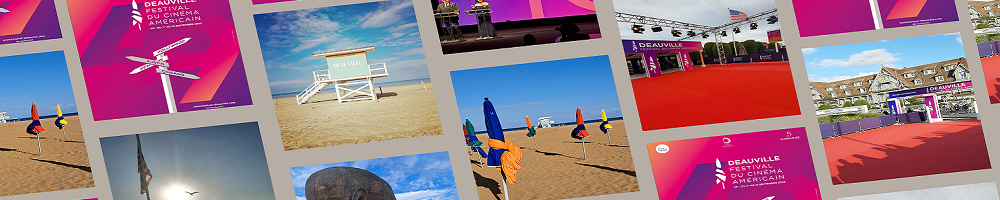






















 L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.
L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.


